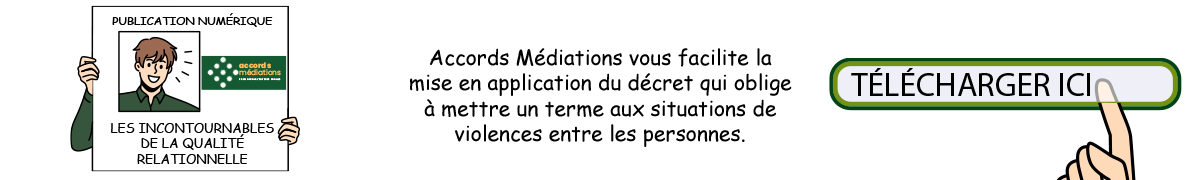de décrypter une actualité ou un fait de société, et vous propose sa vision.
La question des racines n’a jamais été autant d’actualité. Au risque de nous confisquer la possibilité de nous enraciner.
“L’effroyable douceur d’appartenir*”. Cet oxymore qui clôt le best-seller de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, traduit bien le besoin d’ancrage que ressentent celles et ceux qui reviennent dans leur région d’origine après des années passées dans les grandes métropoles. Souvent perçu comme un renoncement, un déclassement ou, pire, un échec, ce come-back s’inscrit dans le mouvement plus large d’un retour au local. D’un retour aux racines. D’un retour de bâton conservateur ? Sa proximité avec des valeurs conservatrices rend, en effet, la thématique de l’enracinement vulnérable à une captation par l’extrême droite. Avec le risque de laisser le champ libre aux simplifications qui déforment allégrement l’enracinement en repli sur soi.
Cette défiguration ne s’arrête pas, néanmoins, aux portes de l’extrême droite. L’écologie de gauche ou le courant altermondialiste ont tenté, et tentent toujours, de se réapproprier des valeurs pourtant ancrées de l’autre côté de l’échiquier. Ce n’est plus un territoire qu’il s’agit de protéger de menaces extérieures mais une “zone à défendre” des velléités gouvernementales. Il ne s’agit pas ici de distribuer les bons points, de distinguer de bonnes pratiques d’affirmation de l’enracinement de pratiques plus détestables. Il convient bien entendu de ne pas associer les luttes qui s’organisent, localement, pour la préservation d’un écosystème aux relents de racisme de la rhétorique völklich ou identitaire sans toutefois occulter que les intentions de certains “zadistes” sont pour le moins ambigües. On pourrait toutefois s’attendre à ce que certaines manifestations redonnent à l’enracinement une couleur moins sombre. Paradoxalement, pourtant, l’enracinement est une fois de plus montré du doigt. Ce qui rend plus difficile encore la tâche de celles et ceux qui, en raison d’aléas climatiques ou de conflits armés, se retrouvent déracinés, avec l’obligation de faire racine ailleurs.
 Décryptez les enjeux de la communication avec l'atelier Étude SIC !
Décryptez les enjeux de la communication avec l'atelier Étude SIC !
Inscrivez-vous dès maintenant et développez vos compétences en analyse des interactions.
Je m'inscris !Prendre racine
Pourtant, l’enracinement n’a pas toujours eu mauvaise presse. En témoignent, par exemple, les réflexions à son sujet de Simone Weil. La philosophe le compte même parmi les besoins fondamentaux de l’être humain. Ce dernier, écrit-elle, “a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l’existence d’une collectivité qui conserve vivants certains trésors du passé et certains pressentiments d’avenir (…). Il a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle, par l’intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie**.” Naturelle, cette participation est ce dont nous héritons sans l’avoir choisi véritablement ; elle constitue cette appartenance non-choisie que nous supportons de plus en plus mal. En effet, dans nos sociétés individualisées à l’excès, tout ce qui relève plus ou moins d’un héritage est généralement perçu comme un fardeau sous le poids duquel nos épaules flanchent et notre liberté s’effrite. Rarement, l’héritage est appréhendé comme un terreau fertile, comme un legs qu’il nous reviendrait à notre tour d’enrichir et de transmettre. Nous cherchons bien plutôt à nous en débarrasser par tous les moyens possibles et imaginables.
Pourtant, et bien que “notre héritage ne soit précédé d’aucun testament” (René Char), peu d’entre nous – sinon aucun – ne sont pas des héritiers. Aussi, pour que cet héritage ne soit pas vécu seulement comme la source de tous nos maux, n’est-il pas inutile de revenir une fois de plus aux mots. L’étymologie nous apprend qu’“héritage” vient du latin heres qui renvoie tout à la fois à l’héritier d’une famille et au nouveau jet que pousse une plante par la tige, le tronc ou le pied. La piste étymologique nous enjoint donc de penser l’héritage par le prisme de la métaphore végétale : à l’image du bois contenant la sève qu’il transporte et de la racine maintenant l’arbre qu’elle nourrit, notre héritage nous contient tout autant qu’il nous maintient. Véritable soutien, il ne saurait être un bien que l’on pourrait posséder. Il est ce lien qui nous relie les uns aux autres, les uns et les autres au monde.
Racine carrée
Cette métaphore végétale trouve néanmoins ses limites puisqu’elle risque de nous induire en erreur en nous donnant à penser que les racines sont, pour Simone Weil, d’abord à chercher dans le sol. Au contraire, les racines pour elle sont moins affaire de sol ou de territoire que de culture, de langue ou de règles qui président au vivre ensemble. Il est donc tout à fait possible de filer la métaphore végétale à condition seulement de penser l’enracinement sous l’angle d’une coopération entre les individus et les milieux avec lesquels ils interagissent. Prendre la métaphore végétale véritablement au sérieux résonne comme une invitation à reconnaître le caractère acquis, et donc relatif, de notre identité. En ce sens, être enraciné ne doit pas être vécu comme une condamnation à être déterminé : c’est reconnaître ce que l’on doit à notre “milieu vital” même si l’on peut être amené à quitter notre terre natale, à s’en éloigner, à prendre racine autre part.
Car les racines sont, en général, multiples, ce qui signifie donc qu’enracinement et multiplication des contacts sont complémentaires plus qu’ils ne s’excluent mutuellement. Et c’est ici que réside précisément tout l’intérêt de la conception weilienne de l’enracinement pour notre réflexion. La lecture de Weil, via la métaphore végétale, nous dévoile qu’être enraciné ne signifie pas “tout refuser du monde” ni “se fermer aux influences venues d’ailleurs**”. L’enracinement ne saurait être confondu avec une forme de repli sur soi, ce qui ne veut pas dire qu’il s’approche dangereusement d’un laisser-passer non-hermétique. Il témoigne davantage de notre capacité à accueillir les influences extérieures sans toutefois les subir : il est toute à la fois la figure de notre capacité d’assimilation des apports extérieurs et de résistances face aux agressions.
Désherber les mauvaises herbes
On comprend, dès lors, que les appels actuels en faveur d’un ré-enracinement se trouvent aux antipodes de ce qu’est, selon Weil, l’enracinement. Écrit dans un contexte particulier, le texte que la philosophe consacre à l’enracinement se penche, il est vrai, sur la situation spécifique de la France en 1943. Il est néanmoins possible d’en tirer de riches enseignements. En effet, quand Weil s’attache à comprendre la victoire – temporaire – des Allemands sur les Français, c’est-à-dire deux peuples tout autant déracinés l’un que l’autre, elle oppose l’agressivité des uns à la passivité des autres. Si l’agressivité peut se présenter comme une porte de sortie, elle ne saurait être que temporaire et ne peut, sur le long terme, constituer à elle seule un programme en vue d’un possible ré-enracinement.
De la même manière, l’attitude réactive et exclusive des plus ardents défenseurs actuels de l’enracinement court le risque de se retourner contre elle-même et, en guise d’enracinement, n’offrir que haine de soi et retour du ressentiment. Pire ces tentatives de ré-enracinement qui appréhendent l’enracinement sur le registre de l’affrontement et non de la communion et de la confrontation – les préfixes de ces deux derniers termes provenant du latin cum qui signifie “avec” – peuvent à tout moment se transformer en de véritables entreprises de déracinement au même titre que la colonisation, la déportation, le règne de l’argent ou la domination économique…
Marianne Fougère
Plume vagabonde et indépendante
* Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, Paris, Actes Sud, 2018.
** Simone Weil, L’Enracinement, Paris, Gallimard, coll. Folio essais, 1990.